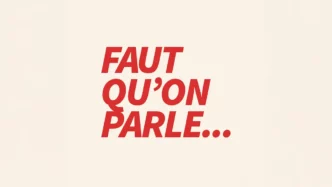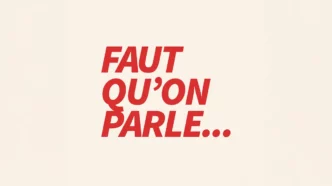L’audition du 28 octobre n’avait rien d’une séance ordinaire.
Une salle sobre, des micros alignés, des députés concentrés.
Et face à eux, un homme au ton calme, précis, presque froid : Emmanuel Razavi.
Grand reporter franco-iranien, il vient témoigner sous serment devant la commission d’enquête sur les liens entre mouvements politiques et islamisme.
Pas pour livrer une opinion.
Pour livrer des faits.
Trente ans d’enquêtes, de Beyrouth à Kaboul, sur les réseaux iraniens, les Gardiens de la Révolution, les Frères musulmans.
Blessé sur le terrain, menacé pour ses révélations, il connaît leurs mécanismes, leurs codes, leurs relais.
Ce jour-là, il ne parle pas d’un “risque d’influence”.
Il décrit un système en marche.
Une pieuvre dont les tentacules s’étendent jusqu’à Paris,
et dont les ramifications, dit-il, “portent aujourd’hui le chaos sur le sol français.”
ROOTS a visionné l’audition.
Près d’1h20 d’un récit dense, glaçant, d’un homme qui parle en journaliste, et en citoyen.
Une lumière froide traverse la salle du Palais Bourbon.
Le président de séance ajuste son micro, rappelle la règle :
« Dites la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. »
Main droite levée, Emmanuel Razavi jure.
Et d’une voix posée, presque contenue :
« Parler de l’islamisme en France, c’est risquer sa vie. »
Un silence s’installe.
L’homme en face des députés n’est pas un polémiste. C’est un grand reporter franco-iranien, trente ans de terrain derrière lui.
Blessé sur le front du Liban, menacé de mort pour ses enquêtes, il a vu de près les réseaux qu’il décrit : ceux de la République islamique d’Iran et de ses relais.
Le système iranien : terrorisme, espionnage, influence
Son propos est méthodique, documenté, presque clinique.
« Depuis 1979, la République islamique d’Iran a fait du terrorisme, de l’espionnage et de l’influence ses trois marques de fabrique. »
Cette trilogie, explique-t-il, n’est pas un vestige de la guerre froide.
Elle structure encore aujourd’hui l’action de Téhéran à l’étranger, et la France, selon lui, est l’un de ses terrains privilégiés.
Objectif : porter le chaos sur le sol français, en instrumentalisant la cause palestinienne.
Les mots comme armes
Pour cela, l’Iran s’appuie sur une grammaire simple.
Des éléments de langage calibrés, diffusés à bas bruit :
Le Hamas est un mouvement de résistance.
L’Iran est un gage de stabilité.
Sans le régime, ce serait la Syrie ou l’Irak.
Ces phrases, dit-il, ne sont pas anodines. Elles naissent dans les bureaux du ministère des Affaires étrangères iranien, puis circulent via les ambassades, les réseaux militants, les intellectuels sensibles au discours “anti-impérialiste”.
Un narratif rodé, séduisant, où l’islamisme politique se fond dans la défense des opprimés.
Avenue d’Iéna : le laboratoire parisien
Razavi désigne un point précis sur la carte :
« À Paris, le centre névralgique des services secrets iraniens, c’est l’ambassade d’Iran, avenue d’Iéna. »
C’est là, dit-il, que des agents épluchent la presse française, notent des noms, repèrent des voix “utiles” : journalistes, chercheurs, diplomates, militants.
Les profils sont ensuite approchés.
Pas dans l’ombre d’une conspiration, mais dans les codes feutrés de la capitale : conférences, dîners, déjeuners dans des restaurants iraniens, réceptions privées.
« Certains refusent, d’autres acceptent. Jamais pour de grosses sommes.
Souvent pour une illusion d’importance. »
Le procédé est classique : créer du lien, puis du crédit.
Un visa facilité pour Téhéran, un reportage, une tribune, une reconnaissance d’“expert”…
Et peu à peu, la parole se fait relais.
Le récit long : de Khomeiny à Arafat
Pour comprendre cette mécanique, il faut revenir en arrière.
En 1973, Khomeiny n’est encore qu’un religieux en exil.
Mais il observe Yasser Arafat, le chef de l’OLP, devenir une icône révolutionnaire, brandissant le revolver à la ceinture sur les couvertures de magazines.
Il comprend que la cause palestinienne est une arme symbolique : romantique, populaire, médiatique.
Il envoie alors son bras droit, Ali Akbar Motachamipour, rencontrer Arafat.
Formé dans les camps palestiniens, Motachamipour reviendra en Iran avec une idée : fusionner le récit islamiste et la dialectique révolutionnaire.
Quelques années plus tard, en 1982, c’est lui qui co-fonde le Hezbollah depuis l’ambassade d’Iran à Damas.
L’alliance est née : islamisme chiite, cause palestinienne et extrême gauche occidentale convergent autour d’un même vocabulaire, anti-impérialisme, antisionisme, lutte contre “l’Occident colonial”.
C’est cette hybridation, dit Razavi, qui nourrit encore aujourd’hui le discours militant importé dans les rues françaises.
Made in Neauphle-le-Château
Mais l’histoire de cette révolution a aussi une empreinte française.
Khomeiny, avant de prendre le pouvoir à Téhéran, vit plusieurs mois à Neauphle-le-Château, dans les Yvelines.
Razavi raconte :
« Le cofondateur des Gardiens de la Révolution m’a confié que c’est là, en région parisienne, qu’ils ont décidé de créer une armée parallèle. Les Gardiens de la Révolution sont nés à Neauphle-le-Château. »
Un détail vertigineux : le berceau idéologique d’une puissance islamiste est né à quelques kilomètres de Paris.
Pourquoi la France ?
Les députés s’interrogent : pourquoi la France ?
Razavi répond sans détour : parce qu’elle pèse.
“Aux yeux de Téhéran, la France est la puissance européenne la plus influente.
Militairement, elle gêne dans le Golfe. Diplomatiquement, elle compte.”
Et surtout : la France a une opinion publique mobilisable, une tradition de gauche tiers-mondiste, un espace politique poreux aux discours de “résistance”.
L’Iran y voit un terrain d’influence idéal, pour peser sur Israël, sur les négociations nucléaires, et sur la diplomatie européenne.
L’arme lente : l’université
Puis Razavi évoque ce qu’il appelle “le temps long”.
L’infiltration universitaire.
Les services iraniens investissent dans les étudiants, les associations, les enseignants.
Certains jeunes iraniens envoyés en France deviennent des relais d’influence, d’autres des informateurs.
“Quand ils approchent un doctorant de 25 ans, c’est parce qu’ils savent qu’à 35, il sera chercheur, journaliste, ou au Quai d’Orsay.”
L’objectif : façonner des voix, créer des futurs relais d’opinion, à l’intérieur même du monde intellectuel français.
Cas français, municipales et clientélisme
Le reporter poursuit : Dijon, Annecy, Lyon…
Des exemples concrets où s’entrecroisent imams fréristes, élus locaux et logiques clientélistes.
Des mairies qui octroient des terrains à des associations douteuses, des élus qui s’affichent avec des imams militants, des listes communautaires qui se constituent au nom du vivre-ensemble.
“Les uns cherchent des voix, les autres une légitimité.
Résultat : la République se fragilise, les réseaux prospèrent.”
Naïveté coupable et vide d’action
Reste la question que tous les députés finissent par poser :
pourquoi rien ne bouge ?
Razavi soupire, puis tranche :
“Des choses illégales, répétées à l’envie, finissent par devenir acceptables.”
Selon lui, la justice manque de formation, les politiques de courage, et les institutions de lucidité.
Les journalistes qui enquêtent sont menacés, parfois seuls.
Et le débat public, saturé d’accusations de “racisme” ou “d’islamophobie”, se replie sur lui-même.
Alors il conclut, sans emphase :
“Il faut un débat national sur ce que nous voulons faire de notre pays.
Sur ce que la République veut encore défendre.”
Épilogue : la voix, le silence, la République
La séance est levée.
Les micros s’éteignent.
Dans le silence qui suit, reste l’écho d’une phrase, prononcée au tout début :
“Parler de l’islamisme en France, c’est risquer sa vie.”
Lire, comprendre, partager.
ROOTS n’interprète pas : il transmet.