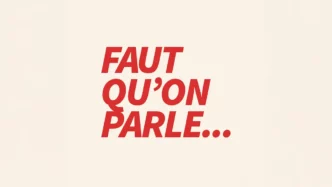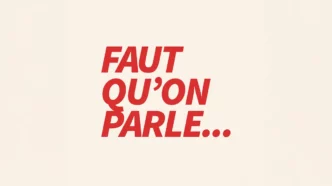Origines et formation
Zohran Kwame Mamdani naît en 1991 à Kampala en Ouganda, au sein d’une famille cosmopolite. Son père Mahmood Mamdani est un universitaire de renom, professeur de sciences politiques et d’anthropologie, et sa mère Mira Nair une réalisatrice indo-américaine de premier plan. Le couple élève Zohran en Afrique – d’abord en Ouganda puis en Afrique du Sud – avant de s’installer à New York en 1999, lorsque Mahmood est recruté à l’Université Columbia. Zohran a alors 7 ans et découvre l’Amérique en même temps que la vie de campus de ses parents sur l’Upper West Side de Manhattan. Issu d’un milieu aisé, il reconnaît avoir eu « une enfance très privilégiée », sans manques matériels – une réalité bien différente de celle de la plupart des New-Yorkais, comme il l’a confié au New York Times en 2025. Cependant, cet environnement familial cultivé et engagé va forger précocement sa conscience politique : enfant, il accompagne ses parents à des rassemblements militants, qu’il s’agisse de manifestations contre la guerre en Irak ou de conférences sur le marxisme. « Quand vous êtes le gamin de deux parents très impliqués dans la justice sociale, vos sorties ressemblent souvent à des réunions ou à des marches de protestation », se souvient-il.
Adolescent, Zohran fréquente le très sélectif Bronx High School of Science, puis part étudier le African diaspora au Bowdoin College dans le Maine, où il obtient un diplôme en études africaines en 2014. Après ses études, il s’essaie à plusieurs voies : conseiller en prévention des saisies immobilières (une expérience marquante au contact des difficultés des classes populaires), mais aussi rappeur. Sous le pseudonyme Young Cardamom, il produit avec un ami ougandais des titres de hip-hop aux sonorités world, et ira jusqu’à composer un morceau pour la bande originale d’un film Disney réalisé par sa mère (Queen of Katwe, 2016). Finalement, c’est vers la politique que Zohran Mamdani se tourne à partir de 2016-2017 : il participe aux campagnes municipales de candidats progressistes à New York, faisant ses premières armes comme directeur de campagne pour Khader El-Yateem (pasteur arabo-américain en lice pour le conseil municipal de Brooklyn) puis pour le journaliste Ross Barkan. En 2020, à seulement 28 ans, Mamdani décide de se présenter lui-même aux élections pour l’Assemblée de l’État de New York. Se réclamant du socialisme démocratique, il bénéficie de l’appui du collectif Democratic Socialists of America (DSA) et du Working Families Party, et défie dans la primaire démocrate la députée sortante du district 36 (Astoria, Queens), Aravella Simotas. Contre toute attente, le jeune inconnu d’origine ougandaise l’emporte et devient en janvier 2021 membre de l’Assemblée de l’État de New York, l’un des tout premiers Américano-Sud-Asiatiques élus à Albany. Il sera réélu sans opposition en 2022 et 2024, tout en s’impliquant dans les luttes locales (logements sociaux, réforme de la police, aide aux migrants, etc.).
Parcours politique et ascension vers la mairie
L’ambition de Zohran Mamdani ne s’arrête pas aux bancs de l’Assemblée d’État. En octobre 2024, fort de sa popularité croissante dans son quartier d’Astoria, il annonce sa candidature à la mairie de New York pour l’élection de novembre 2025. Son programme, centré sur la justice sociale et la baisse du coût de la vie, séduit l’aile gauche du parti démocrate à l’heure où le maire sortant, Eric Adams (modéré et proche des milieux d’affaires), voit sa cote de popularité décliner. Le 27 juin 2025, dans un véritable séisme politique, Mamdani remporte la primaire démocrate face à Andrew Cuomo – l’ancien gouverneur emblématique – en galvanisant la base progressiste de l’électorat. Quelques mois plus tard, le 4 novembre 2025, il confirme son avance lors de l’élection générale face à Cuomo (candidat en indépendant) et au républicain Curtis Sliwa, récoltant environ 50,4 % des voix au premier tour. À 34 ans, Zohran Mamdani devient ainsi le plus jeune maire de l’histoire de New York, mais aussi le premier édile issu de la communauté musulmane et le tout premier à se revendiquer socialiste dans la ville la plus peuplée des États-Unis. Ses parents Mahmood et Mira étaient à ses côtés lors de son investiture symbolique, soulignant le chemin parcouru par leur fils depuis Kampala jusqu’à Gracie Mansion.
Cette ascension éclair s’est appuyée sur une base militante large mais a aussi révélé des fractures idéologiques. Mamdani a bénéficié de l’appui d’organisations progressistes influentes (syndicats locaux, associations communautaires, collectifs de locataires) et de quelques personnalités politiques de gauche. Cependant, pendant la campagne, l’establishment démocrate est resté divisé à son sujet en raison de ses positions jugées radicales. Fait notable, deux poids lourds du parti originaires de New York – le chef des démocrates au Congrès Hakeem Jeffries et le sénateur Chuck Schumer – ont tardé à le soutenir officiellement, reflétant l’inquiétude d’une partie de l’appareil face à ce candidat atypique. Quoi qu’il en soit, l’élection de Zohran Mamdani marque un tournant politique à New York, avec l’arrivée inattendue d’un « outsider » socialiste à la tête d’une ville emblématique. Lui-même l’a proclamé lors de son discours de victoire : « Ce soir, New York a ouvert une nouvelle page. Vous avez délivré un mandat pour le changement, un mandat pour une nouvelle manière de faire de la politique ».
Positions vis-à-vis d’Israël, des Juifs et de l’antisémitisme
Sur la question israélo-palestinienne, Mamdani affiche depuis toujours un point de vue très critique à l’égard du gouvernement israélien. Son engagement pro-palestinien remonte à ses débuts en politique : dès 2020, après sa première victoire électorale, il évoquait déjà « l’apartheid en Palestine » dans un tweet dénonçant le suprémacisme blanc, établissant un parallèle entre les injustices aux États-Unis et l’occupation israélienne. Il est un partisan déclaré du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) et a même introduit en 2023 une proposition de loi visant à interdire aux organisations caritatives new-yorkaises de financer les colonies israéliennes dans les territoires occupés. Pour Mamdani, il s’agit de cohérence avec ses principes anticolonialistes : empêcher que de l’argent américain soutienne ce qu’il considère comme une entreprise de colonisation violant le droit international. Cette démarche lui a cependant attiré de vives critiques : un groupe de ses collègues démocrates à l’Assemblée de l’État l’a accusé de vouloir « diaboliser les œuvres de charité juives liées à Israël ». Mamdani rejette ces reproches, arguant que sa cible n’est pas une religion ou une ethnie, mais bien les politiques d’un État – en l’occurrence, celles du gouvernement israélien d’extrême-droite de Benjamin Netanyahou, qu’il accuse de bafouer les droits des Palestiniens. « Cela me peine d’être traité d’antisémite », confie-t-il, soulignant qu’il distingue clairement son opposition au sionisme politique de toute hostilité envers les Juifs en tant que peuple ou religion.
Cette ligne de crête – anti-sionisme assumé, refus de l’antisémitisme – a placé Mamdani sous le feu des projecteurs à l’automne 2023, lors de la guerre entre Israël et le Hamas. Le 7 octobre 2023, une attaque surprise menée depuis Gaza par les combattants du Hamas fait plus de 1 100 morts civils en Israël et environ 240 otages, déclenchant une riposte militaire d’ampleur de l’armée israélienne sur la bande de Gaza. Mamdani attend alors environ 36 heures avant de réagir publiquement. Dans un communiqué diffusé sur X (Twitter), il se dit endeuillé par « toutes les vies perdues à travers Israël et la Palestine », pleurant les victimes civiles des deux côtés du conflit. Toutefois, il concentre l’essentiel de son message sur la réponse d’Israël qu’il juge disproportionnée : il condamne la décision du gouvernement israélien de couper l’électricité à Gaza et les appels de certains ministres israéliens à une nouvelle Nakba (terme arabe désignant la « catastrophe » qu’a représentée l’exode des Palestiniens en 1948). De telles mesures, avertit Mamdani, « ne pourront qu’engendrer plus de violence et de souffrance dans les jours et semaines à venir ». Il en appelle d’ailleurs à s’attaquer aux causes profondes du cycle de violence : « Le chemin vers une paix juste et durable ne peut commencer qu’en mettant fin à l’occupation et en démantelant l’apartheid ». En employant ces mots – occupation, apartheid – Mamdani s’inscrit dans le vocabulaire des ONG de défense des droits humains, qui comparent le régime israélien dans les Territoires palestiniens aux systèmes ségrégationnistes passés.
La réaction de Mamdani au 7 octobre 2023 a suscité des réactions tranchées. Dans les milieux propalestiniens, on salue le courage d’un élu américain qui ose employer le terme « apartheid » et appeler à cesser le blocus de Gaza en plein conflit. En revanche, de nombreux responsables politiques et associations juives l’ont trouvé unilatéral et choquant, lui reprochant de ménager le Hamas. À l’époque, Mamdani n’avait pas explicitement nommé le mouvement islamiste palestinien dans sa condamnation – contrairement à d’autres élus de gauche comme Alexandria Ocasio-Cortez qui, tout en appelant à un cessez-le-feu, avaient clairement dénoncé « les attaques terroristes du Hamas » Cette prudence de Mamdani a été perçue comme une réticence à condamner le terrorisme, et a alimenté l’ire de ses détracteurs. L’État d’Israël lui-même, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a publiquement fustigé la prise de position de Mamdani en la qualifiant de « honteuse » : « Mamdani a choisi de servir de porte-parole à la propagande du Hamas – en reprenant ses mensonges sur un prétendu génocide, il excuse le terrorisme et normalise l’antisémitisme. Il ne se tient aux côtés des Juifs que lorsqu’ils sont morts. Honte à lui » a cinglé le gouvernement israélien sur les réseaux sociaux.
Confronté à ces attaques et désormais en campagne pour la mairie, Mamdani a dû clarifier sa position. Lors d’entretiens télévisés, il s’est exprimé plus nettement contre le Hamas pour couper court aux accusations de complaisance. « Bien sûr que je condamne le Hamas. Bien sûr j’ai qualifié le 7 octobre de crime de guerre horrible », a-t-il affirmé, par exemple sur le plateau très suivi de l’émission The View début octobre 2025. Il a assorti cette condamnation d’une critique tout aussi vigoureuse de la réponse israélienne à Gaza, qu’il a décrite – au risque de la controverse – comme « un génocide » en cours contre les Palestiniens. Ce double discours (deux poids, deux mesures aux yeux de ses détracteurs, refus de deux poids deux mesures selon ses partisans) illustre la philosophie politique de Mamdani : tous les acteurs doivent répondre des mêmes principes universels. « Je n’ai pas d’opinion sur l’avenir du Hamas ou d’Israël en dehors des questions de justice et de sécurité, et du respect du droit international », a-t-il déclaré en octobre 2025 lors d’une interview, ajoutant que cette exigence « s’applique aussi bien au Hamas qu’à l’armée israélienne ». En d’autres termes, les crimes de guerre doivent être condamnés quel qu’en soit l’auteur – organisation islamiste ou État souverain – et les droits des civils protégés dans les deux camps.
Cette posture a cristallisé le fossé au sein de la communauté juive new-yorkaise autour de Mamdani. D’un côté, l’establishment juif (grandes fédérations, rabbins conservateurs, élus pro-israéliens) s’est majoritairement dressé contre lui, inquiet de voir un défenseur de la cause palestinienne accéder à la mairie d’une ville abritant la plus importante population juive hors d’Israël. Pendant la campagne, plus de 1 150 signataires – dont des centaines de rabbins de tout le pays – ont apposé leur nom au bas d’une lettre ouverte dénonçant la « normalisation de l’antisionisme » que représenterait son élection. Des organisations comme l’Anti-Defamation League (ADL) ont exprimé publiquement leur préoccupation : dès le lendemain du scrutin, l’ADL a annoncé la création d’un “Mamdani Monitor”, un dispositif de veille dédié à scruter les décisions du futur maire impactant la sécurité de la communauté juive. Le ton employé par Jonathan Greenblatt, directeur de l’ADL, était particulièrement sévère : il a accusé Mamdani d’avoir « promu des récits antisémites » et de faire preuve d’« animosité envers l’État juif », promettant de le tenir rigoureusement responsable de la protection de tous les New-Yorkais juifs. Ce sentiment de défiance s’est traduit dans les urnes : un sondage sortie des urnes indique que seulement un tiers des électeurs juifs de la ville ont voté pour Mamdani, contre près de deux tiers en faveur de Cuomo.
D’un autre côté, Mamdani a pu compter sur le soutien d’une frange progressiste de la communauté juive, qui défend une vision universaliste et critique vis-à-vis du gouvernement israélien. Des organisations juives de gauche comme Jewish Voice for Peace (JVP) ou Jews for Racial & Economic Justice (JFREJ) se sont mobilisées sous la bannière “Jews for Zohran”, estimant que les valeurs sociales de Mamdani et sa promesse d’un New York plus équitable étaient en accord avec les principes de justice chers à la tradition juive. « La victoire de Mamdani est une nuit incroyable pour les Juifs progressistes de New York », déclarait l’une des organisatrices juives le soir de l’élection, saluant une coalition inédite entre lutte contre les inégalités locales et plaidoyer pour les droits des Palestiniens. Beaucoup de ces partisans juifs de Mamdani reconnaissent ne pas partager toutes ses opinions sur Israël, mais ils rejettent l’idée que son anti-sionisme soit de l’antisémitisme. Dans une lettre ouverte alternative intitulée “Jews for a Shared Future” et signée par plus de 700 Juifs progressistes, des rabbins affirment que « le soutien du candidat Zohran Mamdani à l’auto-détermination des Palestiniens ne découle pas de la haine, mais de profondes convictions morales » – appelant au dialogue et à la solidarité plutôt qu’au rejet sur des bases identitaires. Ils ajoutent : « La sécurité des Juifs à New York, comme ailleurs, est indissociable de celle de nos voisins. Nous ne pouvons pas bâtir la sûreté des Juifs sur la vulnérabilité des musulmans », dénonçant en creux les attaques islamophobes dont Mamdani a pu faire l’objet (certains de ses opposants n’hésitant pas à agiter le spectre de l’« extrémisme musulman » en rappelant ses origines).
Conscient de ces divisions, Zohran Mamdani a multiplié les gestes d’apaisement envers la communauté juive tout en restant fidèle à ses idées. Il s’est engagé, au-delà des débats sur le Moyen-Orient, à être un maire protecteur envers toutes les minorités. Son programme prévoit ainsi un renforcement massif des moyens de lutte contre les crimes de haine (antisémites, islamophobes, racistes, etc.), avec une hausse promise de 800 % du budget dédié à la prévention des actes antisémites et autres violences discriminatoires. « Je pense que le fait qu’il ait été le seul candidat à avoir un plan clair et précis, s’engageant à octroyer des moyens sans précédent pour prévenir les crimes haineux et protéger les Juifs et tout le monde à New York, est une part importante de son programme », a souligné Jamie Beran, directrice de l’organisation juive progressiste Bend the Arc, pour expliquer son soutien à Mamdani. Ainsi, le futur maire entend démontrer par l’action locale qu’on peut être dur avec l’État israélien tout en assurant la sécurité des citoyens juifs de sa ville – un équilibre délicat qu’il lui appartiendra de concrétiser à City Hall.
Rapports avec le monde arabe, l’Islam et l’islamisme
Issu d’une lignée indo-musulmane d’Afrique de l’Est (ses grands-parents, d’origine sud-asiatique, vivaient en Ouganda), Zohran Mamdani est lui-même de confession musulmane, bien que peu pratiquant. Son identité musulmane fait naturellement partie de son parcours, mais il la porte de manière inclusive et progressiste. Son élection revêt une importance symbolique considérable : il est le premier maire musulman de New York, à la tête d’une ville qui compte plus de 750 000 fidèles de l’islam (soit la troisième communauté religieuse après les chrétiens et les juifs). Cette première a été saluée par de nombreuses organisations musulmanes américaines comme un signe d’avancée dans la représentation politique. Mamdani, de son côté, s’est engagé à veiller à la dignité et aux droits de toutes les communautés religieuses. Il dénonce fermement l’islamophobie – tout comme l’antisémitisme – et a promis que son administration lutterait contre les discriminations visant les musulmans ordinaires, en particulier dans un contexte de crispations liées aux questions de terrorisme et de sécurité. Dans le même esprit, il a défendu le principe que la liberté de culte et le pluralisme religieux font la force de New York, s’opposant par exemple aux registres ou surveillances ciblant spécifiquement les populations musulmanes que certaines politiques post-11 Septembre avaient introduites.
Concernant l’islamisme politique et ses dérives violentes, Mamdani adopte une approche nuancée mais sans complaisance. Il refuse catégoriquement que l’islam en tant que foi soit amalgamé aux actes de groupes extrémistes, mais cela ne l’empêche pas de condamner explicitement ces derniers lorsqu’ils recourent au terrorisme. On l’a vu dans son positionnement sur le Hamas : malgré sa solidarité affichée envers la cause palestinienne, il a clairement qualifié l’attaque du 7 octobre 2023 de « crime de guerre » et insisté sur le caractère atroce du massacre de civils israéliens. Interrogé à plusieurs reprises sur le Hamas, il a finalement déclaré sans équivoque : « Bien sûr que je condamne le Hamas », tout en précisant qu’il considère le respect des lois de la guerre comme impératif pour toutes les parties (impliquant que Tsahal, l’armée israélienne, doit elle aussi se conformer au droit international humanitaire). Cette insistance sur la symétrie des obligations – terroristes islamistes comme armée régulière doivent être tenus de ne pas cibler de civils – lui vient en partie de son bagage intellectuel : Mamdani a baigné dans l’univers académique de son père, spécialiste des études post-coloniales, et dans une vision du monde où la justice est universelle. Il cite volontiers l’histoire pour nuancer les termes chargés idéologiquement : ainsi, rappelait-il lors d’une interview, le mot intifada (souvent associé aux soulèvements palestiniens) signifie « soulèvement » en arabe et a été utilisé par le Musée américain de l’Holocauste pour décrire la révolte du ghetto de Varsovie en 1943. Par là, Mamdani suggérait qu’un terme ou un concept n’est pas intrinsèquement bon ou mauvais hors contexte – une manière de plaider pour une compréhension plus fine des dynamiques politiques du monde arabe et musulman, loin des simplifications idéologiques.
Néanmoins, cette approche intellectuelle peut prêter à controverses dans le débat public. On l’a vu avec l’épisode du slogan « Globalize the intifada » (littéralement : « mondialiser l’Intifada »). Ce cri de ralliement, scandé lors d’une manifestation propalestinienne à New York en 2023, a été interprété par certains comme un appel à étendre la lutte armée anti-israélienne à l’échelle globale, et donc comme une menace pour les Juifs du monde entier. Mamdani, présent à ce rassemblement, avait alors refusé de condamner explicitement le slogan, déclarant simplement que ce n’était « pas un langage [qu’il] utilise » tout en estimant que « le rôle du maire n’est pas de policer les discours ». Cette réponse prudente lui avait valu de vives critiques. Sous la pression des médias et d’adversaires politiques (Andrew Cuomo n’hésitant pas à exploiter le sujet pendant la campagne électorale), Mamdani a dû clarifier sa position à l’été 2025 : lors d’une réunion à huis clos avec de grands patrons new-yorkais, il a assuré qu’il ne reprendrait plus l’expression “globalize the intifada” et qu’il découragerait ses partisans de l’utiliser. Il a expliqué à ces interlocuteurs que, pour de nombreux militants, cette formule n’est qu’une manière d’exprimer un soutien aux Palestiniens et une protestation contre l’occupation israélienne – sens qu’il dit comprendre – mais qu’il reconnaît aussi que les mots « intifada » et « globaliser » résonnent différemment pour la communauté juive, ravivant des peurs légitimes. « Je suis prêt à décourager ce langage précis, mais pas l’idée qui le sous-tend », a-t-il résumé. Par cette concession sémantique, Mamdani cherche à prouver sa bonne foi : il ne souhaite pas alimenter les tensions intercommunautaires inutiles, tout en restant solidaire de la cause palestinienne sur le fond.
En dépit de ses efforts de pédagogie, Mamdani a dû affronter également des critiques venues d’une partie de la communauté arabo-musulmane américaine elle-même, ce qui peut sembler paradoxal. Un petit groupe baptisé “Muslims Against Mamdani” s’est manifesté durant la campagne en distribuant des tracts à Washington Square Park, arguant que Zohran Mamdani n’était pas un bon choix pour les électeurs musulmans. Le chef de file de ce groupe, Adam Azam (un Américano-Pakistanais aux vues conservatrices, candidat malheureux à une élection locale), reproche à Mamdani d’instrumentaliser la question palestinienne alors qu’« un maire de New York n’a aucun pouvoir sur Gaza ou Israël » Surtout, il l’attaque sur ses valeurs sociétales : soutien aux personnes transgenres, défense de la dépénalisation du travail du sexe, etc., des positions progressistes en contradiction selon Azam avec une vision rigoriste de l’islam. Ce faisant, l’initiative “Muslims Against Mamdani” soulignait que l’homme recueille certes un large appui des musulmans de gauche et des jeunes issus de l’immigration, mais qu’il heurte les convictions d’une frange plus conservatrice de l’électorat musulman. Mamdani, pour sa part, assume pleinement son positionnement « islamo-gauchiste » selon ses adversaires : il prône un islam libéral compatible avec les droits LGBTQ+ et l’égalité hommes-femmes, estimant qu’il n’y a pas contradiction entre sa foi personnelle et ses engagements pour les minorités sexuelles ou la justice sociale. En cela, il s’inscrit dans le courant des élus musulmans progressistes à l’instar d’Ilhan Omar ou de Sadiq Khan (le maire de Londres), qui veulent être à la fois des voix anti-islamophobie et des promoteurs de sociétés inclusives, y compris envers des groupes parfois ostracisés par les religieux orthodoxes.
Alliés politiques et adversaires déclarés
Au fil de sa trajectoire, Zohran Mamdani s’est entouré d’une constellation d’alliés issus de la gauche progressiste américaine. Il est membre des Democratic Socialists of America, principal mouvement socialiste aux États-Unis, et à ce titre il a reçu l’appui de nombreux élus et militants affiliés à cette mouvance. Lors de la primaire démocrate pour la mairie, Mamdani a été officiellement soutenu par la quasi-totalité des élus locaux liés au DSA et au Working Families Party, ainsi que par plusieurs figures de la gauche nationale (même si Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, politiquement proches de lui, ont observé une certaine neutralité prudente en public). Des associations locales influentes – en particulier dans son bastion du Queens – se sont mobilisées pour sa campagne : collectifs de défense des locataires, groupes d’entraide de la diaspora sud-asiatique, mouvements de jeunesse climatiques, etc. Mamdani a également obtenu le ralliement de grands syndicats new-yorkais, chose indispensable pour gagner une élection municipale : le puissant syndicat des employés municipaux District Council 37 lui a apporté son endorsement après sa victoire en primaire, voyant en lui un allié des services publics. De plus, comme évoqué précédemment, il a bénéficié d’un soutien enthousiaste d’une partie de la communauté juive progressiste (Jews for Zohran) et de la communauté musulmane. En somme, ses alliés forment une coalition hétéroclite rassemblant la gauche new-yorkaise « de combat » (antiraciste, altermondialiste, éco-socialiste), des travailleurs du secteur public, des minorités ethniques en quête d’une meilleure représentation, et une jeunesse politisée avide de rupture avec les politiques centristes. Cette base plurielle, unie par un désir de changement social, a été décisive dans son accession à la mairie.
Face à lui, Zohran Mamdani a suscité l’hostilité farouche de plusieurs camps adverses, qui se sont retrouvés dans un rejet commun de sa personne. Le premier front d’adversité vient du lobby pro-Israël et d’une partie de la communauté juive traditionnelle, inquiets de voir un militant propalestinien accéder aux plus hautes fonctions municipales. Outre les lettres ouvertes signées par plus d’un millier de rabbins dénonçant ses positions (mentionnées plus haut), sa campagne a vu l’irruption de financements exceptionnels pour tenter de lui barrer la route. Ainsi, le milliardaire juif américain Bill Ackman, patron du fonds Pershing Square et fervent défenseur d’Israël, a versé 1 million de dollars à un super PAC anti-Mamdani intitulé “Defend NYC”. Ackman, qui qualifie régulièrement Mamdani d’extrémiste sur les réseaux sociaux, a expliqué ce financement comme un moyen de défendre l’avenir de New York face à l’antisionisme radical du candidat. D’autres grands donateurs de Wall Street de confession juive, tels que Daniel Loeb, ont également contribué à ces caisses électorales anti-Mamdani (Loeb a donné 100 000 $ à Defend NYC). Sur le terrain politique, l’ancien maire démocrate Ed Koch (avant son décès) ou l’ex-challenger républicain Curtis Sliwa ont multiplié les tribunes et conférences de presse pour alerter contre « le danger Mamdani pour les Juifs ». Sliwa a par exemple accusé le candidat DSA de s’appuyer sur une base « ouvertement antisémite » cachée sous le vernis de l’anti-sionisme – une attaque que Mamdani a qualifiée d’insulte injuste envers les milliers de new-yorkais juifs progressistes qui le soutiennent. Ce climat tendu a créé des malaises jusque dans les synagogues : nombre de rabbins ont évité de prendre publiquement position sur Mamdani, de peur de diviser leurs fidèles, tandis que d’autres ont discrètement rencontré le candidat pour tenter de nouer un dialogue sans vouloir l’assumer publiquement. En somme, Mamdani a, nolens volens, fracturé la communauté juive organisée entre un establishment qui le voit comme une menace et une minorité qui le considère au contraire comme un partenaire potentiel pour une ville plus juste.
Un deuxième cercle d’adversaires s’est cristallisé dans le monde des affaires et de la finance. La plateforme économique de Mamdani – hausses d’impôts sur les grandes entreprises et les riches, gel des loyers, extension massive des protections sociales, renforcement du pouvoir syndical – a suscité la crainte puis l’ire d’une partie du patronat new-yorkais. Dans les semaines ayant suivi sa victoire à la primaire, plusieurs PDG de multinationales ont exprimé publiquement leurs inquiétudes, menaçant parfois de revoir leurs investissements à New York en cas d’application du programme Mamdani. En juillet 2025, Jamie Dimon, le tout-puissant directeur de JPMorgan Chase, a violemment taclé Mamdani lors d’une conférence à Dublin, le qualifiant de « marxiste » irréaliste et dangereux pour l’attractivité économique de la métropole. « Il débite la même bouillie idéologique qui ne veut rien dire dans le monde réel », a lâché Dimon à propos du jeune socialiste. D’autres magnats de la finance ont partagé ce scepticisme, si bien qu’en réaction Mamdani a organisé une réunion privée à huis clos avec un aréopage de dirigeants membres du Partnership for New York City (influente association patronale) pour tenter de les rassurer. Au cours de cette rencontre, il a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas « faire fuir les entreprises de la ville » et qu’il serait ouvert au dialogue avec le monde économique. Néanmoins, il a maintenu que son objectif premier était de rendre la vie des New-Yorkais plus abordable, même si cela passait par des mesures inédites. La perspective de certaines de ces réformes – transports en commun gratuits, épiceries municipales à but non lucratif, gel des loyers des logements à loyer stabilisé – a clairement fait frémir Wall Street, qui y voit une remise en cause du modèle libéral en vigueur. Ces propositions phares (bus gratuits, city-owned grocery stores, encadrement drastique des loyers) ont d’ailleurs déclenché certaines des attaques les plus virulentes de ses opposants financiers, tant elles symbolisent le fossé idéologique entre la vision progressiste de Mamdani et celle du secteur privé new-yorkais. Le ton est donné : bon nombre de patrons et d’investisseurs entendent faire front pour défendre leurs intérêts face à ce qu’ils perçoivent comme une « expérimentation socialiste » à l’hôtel de ville. Mamdani devra ainsi gouverner sous l’œil méfiant – voire l’obstruction – d’une partie de l’élite économique, prête à batailler contre toute politique jugée anti-business.
Enfin, Zohran Mamdani compte un troisième registre d’adversaires, plus traditionnels : le camp conservateur et la droite républicaine. New York est une ville très largement démocrate, et les républicains n’y détiennent que peu de pouvoirs, mais cela n’a pas empêché leur appareil national d’utiliser Mamdani comme un épouvantail idéologique. La National Republican Congressional Committee a par exemple diffusé des messages associant l’image de Mamdani à celle de figures démocrates nationales, pour mobiliser ses donateurs en affirmant que le parti de Joe Biden est « tombé aux mains d’extrémistes antisionistes et socialistes » – Mamdani incarnant selon eux ce virage radical. L’ancien président Donald Trump s’en est aussi mêlé, profitant de la notoriété de l’élection new-yorkaise pour attiser la polarisation : dans une publication sur son réseau social en octobre 2025, Trump a qualifié Zohran Mamdani de « fauteur de troubles anti-police » et a mis en garde que s’il ne « respectait pas Washington », la ville en paierait le prixj. Mamdani a rétorqué qu’il ne serait « pas un maire qui appelle Trump pour éviter la prison, ni un gouverneur déchu [Cuomo] qui quémande son aide pour gagner une élection » – allusion mordante aux déboires judiciaires de Trump et à l’alliance implicite de Cuomo avec ce dernier en campagne. Le nouveau maire s’est même dit prêt à coopérer avec l’administration Trump sur certains dossiers apolitiques comme la lutte contre la vie chère, tout en se posant en antithèse du trumpisme sur les valeurs. Le conservatisme local, incarné par des personnalités comme Curtis Sliwa ou le tabloïd New York Post, n’a pas désarmé pour autant : dans les derniers jours de la campagne, leurs critiques ont porté sur des sujets tels que la sécurité publique (Mamdani ayant été associé au slogan « Defund the Police » en 2020, avant de s’en distancer et de présenter ses excuses aux policiers pour ses propos passés) ou des attaques ad hominem (le Post a ressorti qu’il détenait encore récemment la double nationalité ougandaise et avait été photographié posant avec un ministre ougandais homophobe, insinuant une compromission, ce à quoi Mamdani a répondu qu’il avait renoncé à sa citoyenneté ougandaise et qu’il combat fermement l’homophobie partout). Au soir de l’élection, le camp républicain a dû concéder la nette victoire de Mamdani, non sans prédire l’échec futur de son « laboratoire socialiste » – la chaîne conservatrice Fox News allant jusqu’à annoncer que les New-Yorkais allaient devoir « subir les conséquences de leur vote » pour apprendre à leurs dépens l’erreur d’avoir élu un maire de gauche radicale. Mamdani a conscience de cette opposition idéologique frontale, mais la balaye d’un revers de main en soulignant qu’il a été élu précisément pour changer un status quo jugé intenable par beaucoup.
Ambitions futures et défis à venir
À l’aube de son mandat (entrée en fonction prévue le 1ᵉʳ janvier 2026), Zohran Mamdani fait face à des attentes immenses. Son programme de campagne, très ambitieux, constitue en soi une rupture avec les politiques municipales traditionnelles des dernières décennies. Parmi ses promesses phares pour redonner du pouvoir d’achat et de la dignité aux New-Yorkais modestes, on peut citer : l’instauration de la gratuité des bus de ville (fare-free buses), la création d’un réseau d’épiceries municipales à but non lucratif pour lutter contre la vie chère dans les quartiers populaires, le gel des loyers pour les deux millions de locataires en logements à loyer stabilisé, la construction massive de logements sociaux, l’accès universel et gratuit à la garde d’enfants (public child care), ou encore le relèvement progressif du salaire minimum local à 30 $ de l’heure d’ici 2030. Ces mesures, qui semblaient utopiques il y a peu, font désormais partie du cahier des charges sur lequel Mamdani sera attendu. Par exemple, il a d’ores et déjà annoncé vouloir décréter un moratoire sur les hausses de loyer dans les immeubles stabilisés, et « utiliser toutes les ressources disponibles » pour étendre l’offre de logements abordables. Il compte également créer dès la première année de son mandat une agence publique d’alimentation pour lancer les premières épiceries pilotes gérées par la ville, afin de proposer des denrées à prix coûtant dans les quartiers mal desservis. L’une des mesures les plus commentées est son projet de rendre gratuits les bus MTA, financés par la ville, afin de soulager les travailleurs précaires des frais de transport. Chacune de ces propositions se heurte à des obstacles pratiques (financements à trouver, compétences juridiques à clarifier, opposition de certains lobbys), si bien que nombre d’observateurs s’interrogent sur la capacité du jeune maire à réellement tenir ces promesses. La presse locale, tout en saluant l’ampleur de son mandat électoral, souligne qu’il lui faudra prioriser et sans doute modérer certaines ambitions en négociant avec le Conseil municipal, l’État de New York et d’autres acteurs influents. Mamdani, conscient du défi, a constitué une équipe de transition incluant des experts en politiques publiques et des économistes hétérodoxes, persuadé qu’il est possible de financer son programme en réorientant le budget (il pointe par exemple les dépenses de sécurité et les subventions aux entreprises qu’il juge excessives, qu’il voudrait redéployer vers le social).
Sur le plan des relations communautaires et de la cohésion de la ville, le futur maire aura aussi fort à faire. Sa campagne a laissé des traces : il hérite d’une ville où, en cette période de tensions internationales, les crispations identitaires sont vives. Les incidents antisémites ont augmenté à New York durant la guerre Israël-Hamas de 2023-2024, de même que les actes antimusulmans, et chaque mot du nouveau maire sera scruté. Conscient de cela, Mamdani a déjà entamé un « tour de réconciliation » dès son élection : il a visité plusieurs synagogues et institutions juives pour y dialoguer directement avec les fidèles inquiets. Il a promis d’être le maire de tous les New-Yorkais et insiste sur son message de campagne : « la sécurité de chacun dépend de la sécurité de tous ». Cette philosophie du « destin lié » l’amènera peut-être à modérer certaines de ses expressions publiques sur le conflit moyen-oriental afin de ne pas raviver les divisions locales. Nul doute toutefois que Mamdani continuera de faire entendre la voix de New York sur la scène internationale d’une manière inédite. Traditionnellement, les maires new-yorkais entretiennent des liens privilégiés avec Israël – voyage officiel à Jérusalem en début de mandat, jumelages, etc. – et adoptent un ton résolument pro-israélien. Mamdani pourrait rompre avec cet usage : il a indiqué qu’il n’avait pas peur de critiquer même des alliés historiques des États-Unis si les droits humains sont en jeu. Par exemple, il n’a pas exclu de boycotter certaines cérémonies ou voyages diplomatiques s’il estime que cela cautionnerait des politiques contraires à ses principes (beaucoup se demandent s’il se rendra en Israël en 2026, un déplacement que tous ses prédécesseurs effectuaient, mais sur lequel il reste évasif). En revanche, il a aussi cherché à rassurer les milieux diplomatiques en affirmant qu’il respecterait le rôle limité d’un maire : « Je sais quelle est la portée de mes responsabilités. Mon combat pour la justice internationale, je le mène d’abord en faisant de New York un exemple » a-t-il déclaré en substance. Quitte, donc, à mettre légèrement en sourdine son verbe militant sur la scène mondiale pour se concentrer sur la réalisation concrète de ses promesses domestiques.
En définitive, Zohran Mamdani entame son mandat avec un cap clairement affiché : faire de New York un laboratoire d’une politique municipale résolument progressiste, tout en symbolisant une ouverture nouvelle dans la représentation de la diversité (jeune, musulman, africain d’origine et sud-asiatique, socialiste déclaré – du jamais vu pour un maire new-yorkais). Ses partisans voient en lui l’incarnation d’un espoir : celui qu’une métropole géante puisse être gouvernée à gauche toute, en luttant contre les injustices sociales et en défendant les droits des opprimés, du local à l’international. Ses détracteurs, eux, prédisent un choc avec la réalité et le tiennent pour responsable par avance du moindre raté, prêts à l’attaquer sur tout terrain – insécurité, budget, éducation, diplomatie urbaine – où il pourrait faillir. Le principal intéressé, fort de sa légitimité démocratique, aime à rappeler que son élection n’est pas un hasard mais le fruit d’un mouvement de fond : « New York, ce mandat pour le changement, c’est vous qui l’avez voulu » a-t-il lancé à la foule en liesse le 4 novembre. La tâche qui l’attend est immense, et le « portrait véritable » de Mamdani ne pourra se dresser qu’à l’aune des résultats qu’il obtiendra dans les prochaines années. En attendant, il demeure fidèle à l’image qu’il s’est construite : celle d’un homme politique intransigeant sur les faits et les principes, même à contre-courant, mais prêt au dialogue et à la transparence – en somme, un idéalisme pragmatique qu’il devra transformer en actes au service des New-Yorkais de toutes origines. L’histoire retiendra peut-être Zohran Mamdani comme le premier à avoir marié l’héritage de Mahatma Gandhi (pour la désobéissance civile anticoloniale) et de Bernie Sanders (pour le socialisme municipal) sous les néons de la Grosse Pomme. C’est du moins le défi qu’il s’est lancé, sous le regard du monde entier.
Sources : Les informations et citations de ce portrait sont tirées de sources journalistiques et documentaires diverses, notamment
- People : people.compeople.com,
- amNewYork : amny.comamny.com,
- CBS News : cbsnews.comcbsnews.com
- Jewish Telegraphic Agency : jta.orgjta.org
- The Guardian : theguardian.comtheguardian.com
- Washington Jewish Week : washingtonjewishweek.com,
- Fox Business : foxbusiness.com,
Afin de garantir une représentation factuelle et équilibrée du parcours et des positions de Zohran Mamdani. Toutes ces sources confirment les éléments évoqués et permettent d’établir un portrait ancré dans la réalité, loin de toute déformation partisane ou idéologique.